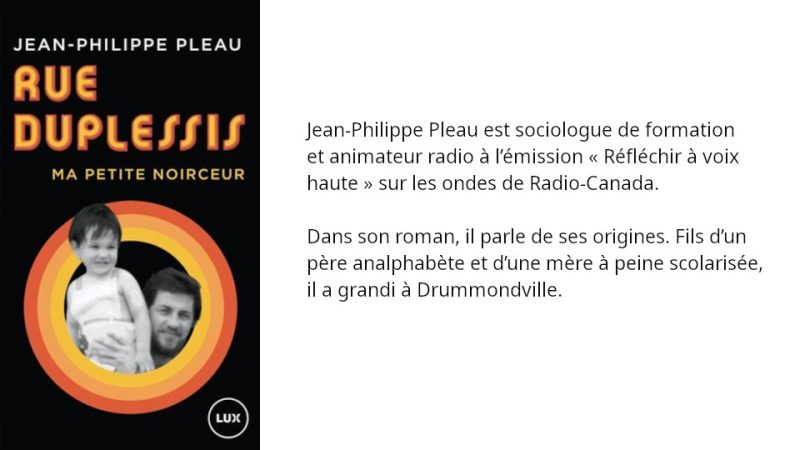Depuis le 30 octobre dernier, les personnes atteintes d’Alzheimer peuvent demander l’aide médicale à mourir de façon anticipée au Québec. Or, divers obstacles cliniques, éthiques et légaux risquent de compliquer la tâche des professionnels qui se chargeront de traiter ces demandes.
« Il a des enjeux sur différents plans et à différents moments du processus, d’où la complexité de l’affaire. » Maryse Soulières, professeure de travail social à l’Université de Montréal, s’intéresse aux défis que risque de poser la récente modification de la Loi concernant les soins de fin de vie.
Cette loi permet maintenant aux Québécois ayant un diagnostic de trouble cognitif dégénératif (comme l’Alzheimer) de formuler une demande anticipée d’aide médicale à mourir, qui pourra être exécutée une fois que la personne aura perdu sa capacité à consentir aux soins.
La professeure s’est penchée sur le cas des Pays-Bas, où une loi similaire est déjà en vigueur depuis plusieurs années. Elle a procédé pour ce faire à l’analyse de documents officiels et à des entretiens avec des informateurs clés. Ses recherches révèlent que de nombreux obstacles compliquent l’évaluation et l’exécution des demandes anticipées par les médecins néerlandais.
Un processus médical complexe
« Il y a souvent des zones grises et des fluctuations au niveau des symptômes, explique Madame Soulières. Une journée, on est bien, une autre journée, on est moins bien. C’est donc difficile de déterminer quand le moment [d’administrer l’aide médicale à mourir] est venu. »
En effet, le patient doit identifier, en rédigeant sa demande anticipée, les manifestations cliniques (symptômes) de la maladie qu’il juge intolérables. Lorsque ces manifestations se présenteront de façon récurrente, elles devront mener au déclenchement d’une demande d’aide médicale à mourir.
Or, une fois le patient devenu inapte, il incombe au médecin de déterminer, souvent en s’appuyant sur l’avis des proches, si ces manifestations sont effectivement présentes. Ce processus peut s’avérer d’autant plus complexe en cas de désaccord entre les divers acteurs impliqués.
« Les professionnels peuvent avoir une lecture différente des proches, ou les proches entre eux peuvent avoir des lectures différentes. On n’est pas toujours dans un consensus », affirme la chercheuse.
L’administration de l’aide médicale à mourir par directives anticipées pose également d’importants défis. Ceux-ci sont notamment dus à la résistance aux soins que peuvent exprimer certaines personnes touchées par l’Alzheimer.
« Concrètement, avec quelqu’un qui résiste aux soins ou qui est anxieux, qui se débat, on fait quoi? s’interroge Mme Soulières. Est-ce qu’on est confortable éthiquement d’utiliser les contentions, les calmants? Ou est-ce qu’on considère ça automatiquement comme un refus? »
Ces questions peuvent amplifier le dilemme des médecins, souvent déjà réticents à l’idée de provoquer le décès d’une personne n’étant plus en mesure de donner son consentement explicite.
En fin de compte, quel impact ces enjeux ont-ils sur le traitement des demandes anticipées d’aide médicale à mourir aux Pays-Bas? « La plupart du temps, ça n’aboutit pas », indique la professeure.
En effet, seul un nombre très restreint de demandes anticipées sont menées à terme chaque année, dont 8 en 2023 selon les données officielles collectées au pays.
Entre Québec et Ottawa : un flou juridique
Au Québec, un élément de complexité s’ajoute du fait que le Code criminel canadien n’a pas encore été modifié pour permettre les demandes anticipées d’aide médical à mourir. Celles-ci demeurent donc officiellement illégales en vertu de la loi fédérale.
Le gouvernement canadien reconnaît toutefois l’autonomie des provinces en matière d’administration de la justice et assure qu’aucune action judiciaire ne sera menée pour contester la loi québécoise autorisant ces demandes. Cela suffira-t-il à assurer la protection juridique des professionnels qui procéderont à l’aide médicale à mourir par directives anticipées?
« Je ne suis pas experte en droit, mais je crois que les risques [de problèmes juridiques] sont vraiment très faibles » affirme Maryse Soulières. La chercheuse rappelle que la situation était comparable lorsque le Québec a légalisé l’aide médicale à mourir en 2015. À l’époque, le fédéral avait mis un certain temps à s’adapter sans pour autant faire entrave à la loi provinciale.
Elle reconnaît cependant que ce flou juridique, et la crainte de poursuites judiciaires de la part de proches opposés à l’exécution d’une demande anticipée, pourraient dissuader certains professionnels de s’engager dans l’aide médicale à mourir dans ce contexte.
« Ça donne un espace aux gens pour penser qu’il y a des recours, souligne Mme Soulières. Je comprendrais que ça puisse, ne serait-ce qu’inconsciemment, influencer l’évaluation du médecin. »
Compte tenu du contexte juridique incertain, le Collège des médecins (CMQ) et l’Association canadienne de protection médicale (ACPM) enjoignent leurs membres à faire preuve de prudence face aux demandes anticipées d’aide médicale à mourir.
Bien qu’il reconnaisse que ces demandes constituent une « avancée importante pour un grand nombre de patients québécois », le président du CMQ, le docteur Mauril Gaudreault, affirme que « des inquiétudes persistent au sujet de la protection juridique des médecins ». L’APCM invite quant à elle les médecins québécois qui envisagent traiter de telles demandes à communiquer avec elle au préalable afin de pouvoir leur fournir des « conseils pertinents ».
Le fédéral ne ferme toutefois pas la porte à une éventuelle modification de son code criminel. Pour paver la voie à un tel changement, le gouvernement canadien a entrepris, à la fin novembre, une « conversation nationale » au sujet des demandes anticipées d’aide médicale à mourir.
Cette démarche mobilisera différents acteurs (patients, gouvernements provinciaux et territoriaux, fournisseurs de soins, intervenants, peuples autochtones et grand public) par le biais de tables rondes virtuelles et d’un questionnaire en ligne ouvert au public.
Ces activités se dérouleront jusqu’en janvier 2025, et Santé Canada publiera un bref sommaire des conclusions au printemps 2025.
Rédigé dans le cadre du cours RED2201
Remis le 16 décembre 2024
Sources :
Entretien avec Maryse Soulières, École de travail social, Université de Montréal, décembre 2024
Regional Euthanasia Review Committees, Annual Report 2023, avril 2024.
La Presse canadienne à Québec, Les demandes anticipées d’aide médicale à mourir sont désormais acceptées au Québec, Le Devoir, 30 octobre 2024.
Marie-Ève Cousineau, « Prudence », dit le Collège des médecins, La Presse, 30 octobre 2024.
Gouvernement du Canada, L’aide médicale à mourir : Conversation nationale sur les demandes anticipées, 28 octobre 2024.